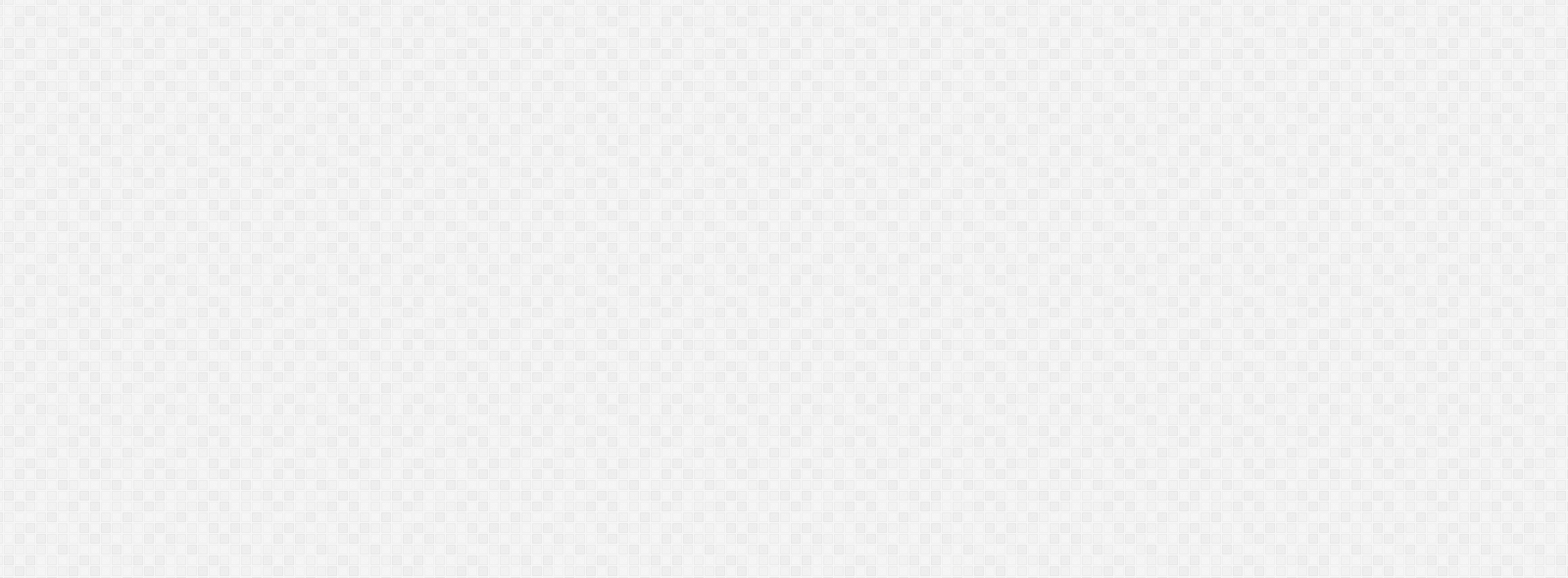Deux questions agitent le monde : le changement climatique, et la guerre sourde que se livrent les deux puissances, dominante et en quête de domination, à savoir respectivement les Etats Unis et la Chine. Ces deux questions ne sont pas totalement indépendantes, et elles sont globales, c’est-à-dire qu’elles concernent toutes les nations, de la plus petite à la plus grande.
Pour reprendre Gramsci, l’ancien monde se meurt, le nouveau tarde à venir, et dans ce clair-obscur, naissent les monstres. Et la première vague est là, de la guerre en Ukraine jusqu’au moindre coup d’Etat en Afrique ou ailleurs, en passant par le génocide de Gaza et l’inquiétante montée de la marée brune à travers l’ancienne Europe, l’Amérique et ailleurs.
Tout ce qui se passe aujourd’hui au niveau des relations internationales, n’est point intelligible sans référence directe ou indirecte à ces deux questions. Plus, ce que nous deviendrons, ce que nous vivrons, de notre nourriture quotidienne à notre survie en tant qu’êtres et en tant que nation, est conditionné par ces deux questions ; et le mode d’insertion dans ce nouveau monde constitue le préalable à toute construction nationale. Pendant ce temps, nos penseur-économistes s’entortillent à chercher comment « passer à de nouveaux paliers de croissance » et nos penseur-politiciens s’épuisent à chercher les moyens de « sauver une transition démocratique » qui n’a jamais existé.
Les Etats Unis, de l’hégémonie à la domination
L’hégémonie des Etats Unis a commencé à prendre forme à la fin de la seconde guerre mondiale avec les accords de Bretton Woods, et plus tard au début des années 70, par l’imposition du dollar américain comme monnaie principale de réserve et de paiements internationaux ; ce qui a fait que la puissance américaine a pris la tête des « démocraties » face au « totalitarisme soviétique ». La bipolarité qui s’est alors mise en place était « une hégémonie partagée » ; La guerre froide étant surtout un équilibre de la terreur entre deux blocs militaires, le camp communiste ne constituait qu’une faible menace économique, mais une menace idéologique très étroitement contrôlée et combattue.
La chute du mur de Berlin, en novembre 1989, marque la fin de la rivalité entre Moscou et Washington et celle de l’hégémonie partagée, et de la bipolarité relative ; elle était relative car elle ne couvrait que certaines dimensions : le politique, le militaire et partiellement le technologique. Avec la chute de l’Union Soviétique, les EU sont passés de l’hégémonie relative à l’hégémonie globale, dans le cadre de ce qu’on a appelé « la mondialisation », ou la « globalisation ».
En considérant les relations internationales, l’hégémonie (du grec « Hegemon », qui signifie « gouverneur », chef militaire…) est la domination d’une puissance, d’un pays, sur les autres.
L’hégémonie globale vous octroie le pouvoir de « domination ». Sur le plan économique, être dominant, c’est simplement s’octroyer le droit et le pouvoir d’orienter la distribution de la richesse mondiale entre les différentes nations. Le terme « simplement » risque d’être trompeur au regard de la complexité du processus. Ce pouvoir émane, en effet, de :
-
La maîtrise des réseaux de distribution des biens et des services à l’échelle de la planète ;
-
la maitrise des TIC, et en particulier, des réseaux devenus principale voie de distribution et d’orientation de la demande finale ;
-
Il en découle le pouvoir d’influer l’évolution des cours des principaux produits et la part qui revient à chaque intervenant.
Par ailleurs, la puissance dominante a tendance, avec le temps, à tirer parti de la forte dépendance des autres pays à l’égard de sa monnaie. Exploitant ce « privilège exorbitant », elle peut se permettre de financer n’importe quelle dépense, ou des modèles de croissance qui ne sont viables à long terme que si leurs propres actifs liquides et sûrs font l’objet d’une demande inconditionnelle de la part du reste du monde. Ils peuvent aussi se permettre d’appliquer des sanctions économiques et financières à n’importe quel pays, indépendamment de la légitimité ou non de ces sanctions.
L’impression grandissante de l’usage démesuré et partial de ces privilèges, a fini par ébranler très sérieusement la confiance dans le dispositif économique et financier international. Les pays en développement, notamment les pays africains, y compris nous, après 60 ou 70 ans d’indépendance, ont le sentiment que le développement qui leur a été promis tarde à venir. Dans ces pays, les conditions de vie se sont relativement améliorées en termes de santé ou d’éducation par exemple ; mais ces pays, à très peu d’exceptions près, n’ont pas réussi à construire une économie viable, à réaliser une croissance durable ou à réduire significativement la pauvreté. Pire, la plupart sont ravagés par des conflits internes et régionaux. La domination est également restée continue, même si elle a quelque peu changé de forme.
Autrement dit, dans un monde unipolaire, la notion même de développement a perdu son sens, puisque le pôle dominant à la main haute sur la création et la distribution de la richesse mondialement créée. Nos pays, ont vu leur ambition se réduire à pouvoir arracher le plus de croissance possible de leurs ressources, afin de faire face à la dynamique démesurée d’un mode de vie et de consommation, dont on peut dire qu’il leur est imposé.
Une hégémonie globale en péril
Depuis une dizaine d’années, la domination des EU est mise en question et de plus en plus en péril, par la Chine, qui tendanciellement est entrain de posséder les attributs de la domination. C’est pourquoi, indépendamment du BRICS, le monde est en train de devenir multipolaire, et cela est en soi une remise en question déterminante du système de gouvernance mondiale.
La Chine, en possession des principaux éléments de l’hégémonie – à savoir, la taille économique et humaine, la menace croissante de rattrapage au niveau de la technologie, en particulier des technologies de l’information et des communications, et la puissance militaire- ne peut mettre fin à la domination américaine, qu’en réduisant la mainmise des EU sur la finance internationale, et l’étape cruciale serait la dédollarisation, c’est-à-dire l’abandon du quasi-monopole du dollar US comme monnaie d’échange et comme monnaie de réserve. C’est là, à mon avis, l’un des objectifs majeurs derrière la naissance des BRICS.
Le dernier sommet du BRICS (Août 2023, Johannesburg) est un évènement majeur de par les développements qu’il risque d’avoir sur la configuration des rapports internationaux. Le communiqué commun de ce sommet constitue une référence pour qui veut savoir les orientations de la configuration projetée. De ce long communiqué, nous ne présenterons qu’un extrait, court, mais significatif.
Tout en restant « modéré » sur les apparences, ce communiqué constitue une remise en question des fondements de la gouvernance mondiale. Il souligne L’attachement au multilatéralisme, particulièrement dans le cadre du système des Nations Unies : « Nous réaffirmons notre engagement en faveur d’un multilatéralisme inclusif et du respect du droit international, y compris des buts et principes consacrés dans la Charte des Nations Unies (ONU) comme pierre angulaire indispensable, et du rôle central de l’ONU dans un système international dans lequel les États souverains coopèrent pour maintenir la paix et la sécurité, faire progresser le développement durable, assurer la promotion et la protection de la démocratie, des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, et promouvoir une coopération fondée sur l’esprit de solidarité, de respect mutuel, de justice et d’égalité ».
Cela dit, il prône une réforme globale de l’ONU, surtout de son Conseil de sécurité : « Nous soutenons une réforme globale de l’ONU, y compris de son Conseil de sécurité, en vue de la rendre plus démocratique, représentative, efficace et efficiente, et d’augmenter la représentation des pays en développement parmi les membres du Conseil afin qu’il puisse répondre de manière adéquate aux les défis mondiaux actuels et soutenir les aspirations légitimes des pays émergents et en développement d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, notamment le Brésil, l’Inde et l’Afrique du Sud, à jouer un rôle plus important dans les affaires internationales, en particulier au sein des Nations Unies, y compris de son Conseil de sécurité. […] et nous appelons à une réforme des institutions de Bretton Woods, notamment pour un plus grand rôle des marchés émergents et des pays en développement, y compris à des postes de direction au sein des institutions de Bretton Woods, qui reflètent le rôle des pays en développement émergents dans l’économie mondiale. »
Sur le plan de l’important système de régulation des échanges commerciaux internationaux, le communiqué affirme « le soutien au système commercial multilatéral ouvert, transparent, juste, prévisible, inclusif, équitable, non discriminatoire et fondé sur des règles, centré sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et doté d’un traitement spécial et différencié (TSD) pour les pays en développement, y compris les pays les moins avancés. »
Last but not Least : « Nous soulignons l’importance d’encourager l’utilisation des monnaies locales dans le commerce international et les transactions financières entre les BRICS ainsi que leurs partenaires commerciaux. » ; ce qui signifie « dédollarisation », et équivaut à une véritable déclaration de guerre, au camp occidental.
L’avènement du BRICS constitue, en effet, une menace existentielle pour le pôle dominant. Pour le voir il suffit de considérer les conséquences de la dédollarisation : un véritable scénario cauchemardesque :
-
baisse importante de la demande pour le dollar américain, et perte de valeur de cette monnaie sur les marchés des changes ;
-
augmentation du déficit commercial des EU ;
-
augmentation de l’inflation aux EU ;
-
augmentation du coût de la dette, avec probablement difficultés à l’honorer ;
En somme, les Etats Unis et leurs alliés se trouveraient dans l’obligation de s’ajuster, avec tout ce que cela signifie comme perte de pouvoir et recul de leur standard de vie.
En dépit de cela, Washington a soigneusement évité de montrer la moindre irritation après le sommet de Johannesburg. Commentant les résultats du sommet, un porte-parole du Département d’État US affirme que les BRICS ne sont pas de futurs «rivaux géopolitiques» des États-Unis, et que «les pays sont libres de choisir leurs partenaires et les groupements auxquels ils s’associent». On assure vouloir maintenir de « solides relations » bilatérales avec le Brésil, l’Inde ou l’Afrique du Sud. Cette « modération » de part et d’autre, cache une guerre sourde qui se déroule sur le terrain. Et cette bataille pour « l’après », est engagée depuis longtemps.
Pendant ce temps, la Chine continue à élargir sa sphère d’influence. Les liens économiques et politiques entre la Chine et l’Afrique, par exemple, se sont intensifiés de manière considérable au cours de ce premier quart de siècle. La Chine est devenue un partenaire commercial majeur de la région, elle est aussi devenue une source majeure d’investissements étrangers en Afrique, avec des entreprises chinoises opérant sur le continent. En l’espace de vingt ans, la valeur des exportations chinoises vers l’Afrique a été multipliée par plus de vingt : passant de 5 milliards de dollars en 2000, à plus de 110 milliards en 2020, pour atteindre un montant record de 282 milliards $ en 2022 selon des données publiées par l’administration générale des douanes chinoises, en hausse de 11% par rapport à 2021. Mais il ne s’agit pas seulement d’une voie à sens unique. Les exportations africaines vers la Chine ont également augmenté, bien qu’à un rythme plus lent : passant de 4,9 milliards de dollars en 2000, à 117,5 milliards de dollars en 2021. Ceci touche aussi les investissements chinois en Afrique. Depuis 2011, le géant asiatique a « su devenir le principal acteur du boom des infrastructures sur le continent, participant aux financements des projets à hauteur de 40 % », une part qui ne cesse d’augmenter, dans le cadre notamment du programme stratégique chinois des « Nouvelles routes de la soie« , faisant de la Chine le premier investisseur étranger en Afrique.
Cette mainmise chinoise sur les échanges extérieurs et l’investissement des pays africains, n’est pas animée seulement par des intérêts commerciaux immédiats, mais surtout par la volonté d’élargir sa sphère d’influence aux dépends de l’occident en vue d’une refonte de la gouvernance mondiale. La riposte est bien sûr organisée, et contrairement à ce que pensent certains, nous sommes en première ligne, car dans cette guerre il n’y a pas de petit pays.
Ces « petit pays » intéressent plus que jamais le monde ; et peuvent beaucoup faire ; regardez l’ampleur de l’accueil du président tunisien lors de son dernier voyage en Chine. L’autre camp, directement et à travers les organismes internationaux qu’il contrôle, mène une opération de charme tournée vers le Sud, la dernière est la proposition du président des EU de consacrer deux sièges supplémentaires à l’Afrique, dont un siège permanent, mais sans droit de véto (On n’est pas si fous que ça !). Rappelons-nous aussi, les innombrables va-et-vient de la Cheffe du gouvernement italien en Tunisie accompagnée parfois par de très hauts responsables de la Commission Européenne. Sur ce dernier point, il faut être niais pour croire que c’est seulement pour obtenir de la Tunisie sa collaboration dans la lutte contre l’immigration clandestine. Regardez aussi le « mirobolant » projet de production de l’hydrogène vert et son exportation vers l’Europe.
Casser l’unipolarité est un préalable à tout développement durable et juste. C’est pour cela que ce que l’on appelle désormais « Le Sud Global », a besoin – et applaudit la naissance – du BRICS, et la Tunisie, ne peut que participer à cela. Mais la transition vers un monde multipolaire, qu’elle soit forcée ou négociée, semble aujourd’hui être un rêve fou, tant les intérêts établis sont énormes.
« Compter sur nos propres moyens » ?
Les autorités tunisiennes sont passées à l’acte. En avril 2023 le président Kaïs Saïed déclare devant la presse que « Les diktats du FMI qui mènent à davantage d’appauvrissement, sont inacceptables”, insistant sur le fait que les mesures d’austérité imposées par l’institution financière risqueraient de perturber “la paix sociale” dans le pays”. Kaïs Saïed a ainsi mis entre parenthèses des négociations qui trainaient depuis octobre 2022, en ajoutant que “l’alternative est de compter sur nous-même » ; petite phrase simple mais ô combien lourde de sens et de conséquences ; le FMI étant une institution centrale de l’ordre mondial dominant. Refuser la coopération avec le FMI est un acte emblématique ; et pour le président, ceci est l’un des axes majeurs d’un nouveau combat qu’il qualifie « de libération nationale ».
« Le compter sur nous-même » n’est pas une invention Tunisienne. Suite à la pandémie et aux conflits mondiaux comme la guerre Russo- Ukrainienne, et celle de Palestine, de nombreux pays, et non des moindres, poursuivent des politiques pour renforcer la résilience économique intérieure en proposant des stratégies d’autosuffisance.
Dans son discours sur l’état de l’Union 2022, le président américain Joe Biden a promis de créer une économie dans laquelle « tout, du pont d’un porte-avions à l’acier sur les gardes-rails d’autoroute, est fabriqué en Amérique du début à la fin, Tout. En réponse, le président français a proposé à l’Union européenne de poursuivre sa propre stratégie « Made in Europe ». Le Premier ministre indien Narendra Modi a également promis de créer une « Inde autonome », et même avant que la pandémie n’éclate, la quête de l’autosuffisance de la Chine était bien avancée, le président Xi Jinping ravivant en 2018 le slogan de « régénération par ses propres efforts. «
Pour nous, s’il faut « Compter sur nos propres moyens » pour reprendre le même chemin, alors cela est un non-sens. « Compter sur nos propres moyens » ne peut se faire que dans le cadre d’une rupture. Et cette rupture est au moins douloureuse.
« Compter sur nos propres moyens » signifie qu’on disposera de moins de ressources pour l’investissement, puisque le financement extérieur devra se rétrécir considérablement ; et ce déficit ne peut être entièrement comblé par des ressources intérieures quelle que soit leur source. L’analyse de la structure de nos importations fait ressortir des besoins importants de ressources en devises étrangères. Ainsi, en moyenne, nous importons pour près de 13.7 milliards de dinars de biens d’équipement et nous investissons pour 21.5 milliards de dinars par an. C’est-à-dire que pour chaque dinar investi nous avons besoin de près 640 millimes d’importations directes.
« Compter sur nos propres moyens » signifie aussi qu’on disposera de moins de ressources pour l’activité de production. Nous importons, en effet, en moyenne pour 29 milliards de dinars de matières premières et de semi-produits pour faire tourner notre machine de production (pour « faire tourer le zéro » dans le langage commun), quand on compare au PIB moyen qui est de l’ordre de 110 milliards de dinars, on constate que pour réaliser une valeur ajoutée d’un dinar nous avons besoin de 264 millimes d’importations directes. A cela, il faut ajouter bien sûr les importations de biens de consommation et les charges de remboursement d’une dette extérieure dont la bride a été lâchée depuis la « révolution ».
Or tout ceci doit être payé en devises. La disponibilité de ressources intérieures n’est pas suffisante pour réaliser des investissements et en faire des projets viables. C’est pour cela, entre autres, que l’idée d’une relance par la demande intérieure est aussi problématique que celle de bloquer cette demande. Ceux qui parlent avec légèreté de « création de richesses » doivent y réfléchir à deux fois avant de parler.
Il y a une chose bonne à savoir : on peut difficilement réformer et faire de la croissance en même temps, comme on ne peut pas reconstruire sans détruire auparavant. Le pays est obligé de réduire ses ambitions de croissance et son rythme d’investissement et de consommation. Or s’il y a une chose dont ceux qui régissent notre monde ont horreur, c’est qu’un pays essaie de limiter son activité économique ou sa consommation c’est pourquoi, en dépit des apparences, ils ne cherchent qu’à vous prêter de l’argent quitte à aggraver votre endettement et votre besoin de recourir à leur « assistance ». La fuite en avant est la seule alternative que connaît le capital mondial qui ne tolère aucune pause, et le combat universel oppose -et le fera pour longtemps encore- les défenseurs de cette fuite en avant, à ceux qui considèrent qu’il faut revoir notre mode de vie et notre modèle de consommation. Et dans cette lutte, le rapport de forces est très largement en faveur des premiers.
La prospérité relative que nous avons connue décline et va continuer à décliner. Cela ne nous concerne pas nous seulement. Le monde entier crie que l’ère de la prospérité est révolue et que l’ère de l’abondance est terminée, et nous devons passer à un nouveau mode de vie ; et si nous ne commençons pas à le faire nous-mêmes, nous y serons obligés. Parce que les catastrophes dans lesquelles le monde est en train de sombrer sont intimement liées à ce mode de vie qui est en train de menacer notre survie sur cette terre : changement climatique, exploitation excessive des ressources naturelles, dette excessive et croissante, menaces sur l’avenir de nos enfants, et bien sûr un état de guerre sans fin.
Le désenchantement généralisé à l’égard du système capitaliste actuel a conduit de nombreux pays, riches comme pauvres, à rechercher de nouveaux modèles économiques. Les défenseurs du statu quo continuent de présenter les États-Unis comme une étoile brillante, dont l’économie surpasse l’Europe et le Japon, et dont les marchés financiers sont plus dominants que jamais. Pourtant, ses citoyens sont aussi pessimistes que n’importe quel autre Occidental. À peine plus d’un tiers des Américains pensent qu’ils seront un jour plus riches que leurs parents. La part de ceux qui font confiance au gouvernement continue de baisser, même si l’État met en place un filet de sécurité toujours plus généreux. 70 % des Américains estiment aujourd’hui que le système « a besoin de changements majeurs ou d’être complètement démoli », et les jeunes générations sont les plus frustrées. Les américains de moins de 30 ans sont plus nombreux à avoir une vision plus positive du socialisme que du capitalisme. (source : « Foreign Affairs », septembre 2024)
Le beau temps et le « Zaman Al Jamil » sont définitivement derrière nous, et ces bouleversements constituent paradoxalement une opportunité historique : pour la première fois depuis qu’on nous a déclarés « indépendants » (et c’est vrai pour tout le Sud), le développement devient du domaine du possible, et non plus de celui du mirage.
Quel Alignement dans un monde multipolaire ?
Si la position des autorités tunisiennes à l’égard de la gouvernance mondiale est claire, la question de l’alignement n’est pas encore à l’ordre du jour. La Tunisie commerce toujours avec l’Union Européenne ; et ils élaborent ensemble des projets dont certains sont mirobolants. A l’opposé, lors de la visite du Président tunisien en Chine en Mai 2024, la Chine et la Tunisie ont renforcé les relations bilatérales pour établir un « partenariat stratégique » ; et plusieurs projets entrevus sont très importants, mais encore peu avancés.
Ceci n’est pas, à notre avis, une réminiscence de la supposée stratégie « bourguibienne », en la matière. J’ai entendu au cours d’une émission radiophonique un militant politique dire : « Du temps de la guerre froide, le président Bourguiba avait eu la sagesse de ne pas s’aligner, mais de prendre ses distances vis-à-vis des deux pôles et de « tirer profit » de l’un et de l’autre ». Nous ne nous égarerons pas dans le débat sur la réalité ou non du non-alignement du défunt président ; nous voudrions seulement rappeler ce que nous avons dit plus haut, à savoir que le contexte aujourd’hui est complètement différent. On vit aujourd’hui une bataille d’une rare férocité entre les deux pôles pour étendre leur hégémonie en cherchant à élargir chacun son « espace vital » ; et les armes ne sont plus seulement idéologiques et militaires, mais surtout économiques. Chacun des deux pôles n’est pas prêt à se contenter de pas moins que d’une intégration totale. Pour le pôle actuellement dominant, il s’agit de maintenir et élargir l’hégémonie sur ses espaces vitaux (Amérique latine, Moyen-Orient, …) et éviter leur « fuite » vers l’autre pôle. Pour ses satellites, il y a une volonté non avouée de récupérer leurs anciens empires coloniaux. Pour la Chine, il s’agit, à travers les BRICS, de casser l’unipolarité, et pourquoi pas, plus. Dans tous les cas, chaque composante du « Sud » sera forcée de s’aligner. Dire « forcée », ne signifie pas que cela se fera par la force des armes, même si cela n’est pas exclu dans certains cas, comme l’Ukraine ou la Palestine et maintenant le Liban, en attendant plus.
Cette bataille pour la redistribution des sphères d’influence est en train de prendre toutes les formes, allant des accords de « coopération » et les offres d’investissement jusqu’à l’invasion militaire pure et simple. L’espace ne nous permet pas d’approfondir la question ; mais nous dirons une seule chose : la menace à l’indépendance de la décision nationale n’est pas toujours représentée par des diktats, mais de plus en plus par des tentations qui orientent vos choix en en embellissant certains. Et à regarder de près, d’un œil attentif on peut voir ce qui se cache derrière certaines propositions qui en réalité ne sont pas ce qu’elles semblent si évidemment être.
Dans « L’Hégémonie contestée » (2019), Bertrand Badie observe qu’« au-delà du mythe qui bute sur un inaccomplissement sans cesse plus accusé, il se profile une interrogation encore vague sur ce que pourrait être un monde post-hégémonique. Il serait risqué de le concevoir comme une nouvelle utopie pacifique, un gouvernement du monde ou même simplement une nouvelle étape sur le chemin d’un improbable progrès. Irons-nous vers des « nouvelles vertus ou nouvelles illusions » ? Nous ajouterons de « ou de nouvelles destructions ».
Nous avons, en effet, dit plus haut que la transition pacifique vers un monde multipolaire, qu’elle soit forcée ou négociée, semble aujourd’hui être un rêve fou, tant les intérêts établis sont énormes ; et la conséquence la plus probable en est l’extension du champ des conflits armés localisés (Ukraine, Gaza, Moyen Orient…) avec des risques grandissants de dérapage.
Comment ne plus être que des spectateurs ?
Si ce combat arrive à son aboutissement, il est possible d’affirmer que quelle que soit son issue, le coût pour l’humanité sera énorme, et une voie possible du salut est l’émergence d’un troisième bloc ; et ce bloc ne peut s’organiser qu’autour de la Méditerranée, avec ses trois « rives » : l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient. La Méditerranée n’est-elle pas le centre du monde !
A première vue, ceci semble relever de l’utopie voire de la naïveté. Nous disons « non », tout en avouant que l’entreprise n’est pas facile.
D’abord, sur le plan économique l’Europe est en grande difficulté.
Mario Draghi, l’ex-président de la Banque Centrale Européenne, s’est montré plus alarmiste. Pour lui, l’Union européenne est aujourd’hui confrontée à « un défi existentiel » ; si elle ne change pas, elle sera condamnée à « une lente agonie ». C’était, il y a quelques jours, le 9 septembre, alors qu’il rendait public le rapport sur la compétitivité que la Commission européenne lui avait commandé, il y a un an. Quelques jours plus tôt, devant les présidents des groupes politiques du Parlement européen, l’ancien premier ministre italien avait même confié faire des « cauchemars » quand il imagine ce qui attend les Vingt-Sept pays de l’UE si rien n’est fait. (Lemonde.fr, 09-09-2024)
Selon Mario Draghi, les faits sont là : l’économie européenne a décroché par rapport aux Etats-Unis, tandis que la Chine la rattrape inexorablement. « Le revenu disponible réel par habitant a augmenté presque deux fois plus aux Etats-Unis qu’en Europe depuis 2000 » ; et, selon lui, en l’état actuel des choses, il n’y a aucune raison que cette dégringolade s’interrompe.
Si l’on peut partager sans doute le constat, il y a espace pour diverger beaucoup sur le remède que le rapport Draghi propose. Ses propositions sont en fait assez attendues. Elles se situent sur deux plans : des réformes du fonctionnement de l’UE vers plus de fédéralisme et l’achèvement du marché unique, d’une part ; d’autre part, investir massivement pour renforcer la compétitivité technologique européenne.
Ce qui nous intéresse c’est que le projet Draghi s’inscrit dans la logique du capitalisme, celle de la fuite en avant continuelle, l’image la plus criarde en est les 800 milliards d’euros d’investissement qu’il propose. Ceci est la conséquence logique de l’objectif qui est celui du « rattrapage » des EU et de la Chine, alors que de plus en plus de voix s’élèvent pour mettre un terme à cette course folle qui menace la vie sur terre, et qui en attendant a généré les plus fortes inégalités inter et intra-pays, depuis la naissance du capitalisme. La transition vers un monde multipolaire est vitale, mais cela ne signifie pas s’aligner sur un pôle plutôt qu’un autre. S’aligner sur l’un des pôles, c’est s’inscrire dans cette logique qui se comprend pour les pays concernés par la course à la domination, mais ne comporte pour l’ensemble de l’humanité que des risques énormes. L’alignement inconditionnel du « gouvernement de l’Europe » derrière les Etats-Unis (certains parlent plutôt de vassalisation de l’Europe) a contribué à verser de l’huile sur le feu et, je le pense à sa propre « décadence ».
Ensuite, le projet Draghi -même si objectivement il n’a que peu de chance d’être suivi- risque d’être la voie pour exténuer encore plus l’Europe dans une course folle, qui en plus d’être probablement perdue d’avance, s’inscrit dans la voie d’une plus grande destruction de la planète. Un partenariat basé sur un pacte de développement commun réel et durable dans le cadre de l’espace E-M-A (Europe, Méditerranée, Afrique), permettra à l’Europe de construire une nouvelle prospérité, qui serait un modèle pour le monde.
L’Europe est notre premier partenaire sur tous les plans, y compris – et avant tout – culturellement. Pour prendre l’exemple de la Tunisie, nous sommes à quelques encablures de l’Italie, et nous partageons avec elle plus de siècles d’histoire commune qu’avec toute autre péninsule. Des centaines de milliers de tunisiens sont maintenant européens, et leur nombre ira en grandissant. Je suis de ceux qui croient que notre avenir sera en grande partie lié à l’Europe, mais pas de n’importe quelle manière. Une Europe qui aura compris que son avenir est avec son sud, et pas outre-Atlantique.
Les analyses objectives de l’histoire des cadres contractuels de « coopération » de l’Europe avec ses partenaires du Sud, montrent que ces cadres ont constitué un instrument d’une nouvelle forme de domination (plus subtile et plus pernicieuse) que ceux d’un réel développement de ces partenaires. L’Europe d’aujourd’hui, quoiqu’on en dise, ne semble pas être près de sortir de l’approche néocoloniale qu’elle a adoptée depuis l’accès à l’indépendance des pays de son ancien empire colonial. Nous en prenons comme témoin les nouvelles perspectives économiques qu’on nous fait miroiter, comme le mirobolant projet de « l’Hydrogène Vert » auquel nous consacrerons un jour une analyse à part. Ce penchant néocolonial est aggravé par la montée en Europe des partis de la droite dure, qui comme toujours continuera à lâcher la proie pour l’ombre ; la question de l’immigration en est un aspect très symptomatique.
On n’a jamais été aussi bien placés pour en discuter, avec l’appui les forces de progrès qui se battent chez elles pour une société plus respectueuse de l’environnement et de la vie, pour des rapports plus équitables entre les peuples, et pour le respect de la diversité culturelle et des droits de l’homme. C’est avec ces forces de progrès que le nouveau monde est à construire.
Un grand journaliste économique français a conclu une remarquable intervention, lors d’une rencontre organisée par ce journal, et à laquelle j’étais convié, en disant : « Je crois qu’il existe une grande déception au sein de l’Union Européenne à l’égard de la Tunisie, parce que les autorités tunisiennes ne proposent jamais de nouvelles idées. C’est un dialogue d’indifférence. Et s’ils me demandaient aujourd’hui, comme il y a cinq ou dix ans : quelle est la politique économique de la Tunisie ? Je ne pourrais pas répondre, parce que je ne la vois pas. » Ceci est vraisemblablement vrai depuis des décennies. Aujourd’hui, ce projet existe probablement ; mais un projet n’existe réellement que s’il est élaboré et rendu public.
Il est temps de cesser d’être les spectateurs de notre propre déchéance : voici pour les autorités tunisiennes un projet passionnant : élaborer un projet et organiser une grande conférence euro-méditerranéenne-africaine pour élaborer le « Pacte EMA de développement réel et durable ».
M.H. Zaiem